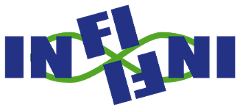-
Grall Jean Marie
Liste arts de la rue
Archives de la liste Aide
- From: stef filok < >
- To: < >, < >
- Subject: [rue] rue du risque
- Date: Wed, 10 Oct 2012 16:10:12 +0200
- Importance: Normal
|
je crois qu'à lors actuel on parle plus du non risque , sauf si on a des subs à gogo et qu'on se foutte de la réussite et de l'échec.
Nous en sommes tellement à faire des économies de bouts de ficelles que nous créons 4 spectacles cette année, marionnettes de rue, 2 déambulatoires, et un solo pas de budget, ou peu, et surtout une épée de damoclès rappelant étrangement le sigle du crédit agricole au dessus de la tête de chacun de nous,... Le risque réside dans le fait qu'une jeune compagnie n'ayant pas suffisamment la connaissance d'un public lambda et croyant détenir la clé des arts de la rue pourrait fort réviser sa copie dès sa 1ere sortie de résidence,... impliquer des gens dans ses projets s'ils tombent à l'eau entraine en peu de temps la désertification due à un "il faut bien manger". la création est fragile, le risque est partout, répéter un spectacle de plein air en normandie est un risque, perdre un comédien charnière durant une créa est un risque, alors cette année on a voté le risque 0, Dérapage a du mal à se vendre parce que la fin est trop dure,... les organisateurs ont du mal à trouver un 1er étage pour strada j'aime,,etc... bref, le risque c'est bien quand on a 20 ans, après les os se brisent. Date: Wed, 10 Oct 2012 11:07:58 +0200 From: To: Subject: [rue] du risque, par Hubert Colas Ci-après un peu de matière glanée dans Alternatives théâtrales autour de la notion de risque... bien à vous Hubert Colas Je risque d’être ou je risque quoi à être D’après un entretien avec Judith Martin ON RISQUE OÙ? ( au théâtre?) Dans l’action, dans l’engagement. On risque quoi ? Le regard. Le risque, c’est quoi, parler d’un temps, d’un espace, d’un regard hors du commun. Oser encore s’interroger. Pas pour y inscrire quelque chose de spécifiquement nouveau. Il y a risque peut-être pour inciter un déplacement, un regard, une écoute. Risquer être en dehors des frontières de l’ère du tout communicant. La première sensation à cette question est qu’il n’y a pas de risque à faire ce que je fais et la deuxième c’est que cela ne va pas sans risque. Ne pas prendre de risque ? C’est être là où ce qui est représenté s’entend, se voit, se perçoit comme un élément déjà connu. C’est être là où l’exercice d’être spectateur n’est plus sollicité, mais conforté. C’est être là où rien ne bouge. C’est voir de l’identique pour de l’identique. Un lieu où ce que l’on voit nous fait croire à ce que nous voulons qui soit, avec un zeste de «Il faut faire quelque chose pour..., cela raconte ceci ou cela, j’ai vu ça déjà et c’est vrai que...». Un conformisme ambiant de la représentation. En ce lieu-là, le politique n’a aucune crainte que son électorat ne se disperse, ne se dissolve dans la réflexion d’un savoir autre. La consommation demande des objets consommables pour la consommation. Des objets sans risque qui se mangent vite. Il faut que le théâtre ressemble au théâtre. S’il ressemble à autre chose, à quoi peut-il bien ressembler ? Quelqu’un en aurait-il peur ? Et de quoi aurait-il peur ? Qui franchit le risque ? Quelque chose aurait-il le pouvoir de changer quelque chose dans le regard de certains... ? Mais le théâtre n’a rien à changer. Il est ce qui change. Et pas pour changer mais pour être à l’image de ce qui change en nous et de notre perception du monde. Il n’y a plus aucun risque. Le risque a été avalé par la forme. Un risque bourgeois qui s’émoustille sur son siège lorsque l’un d’entre nous, un artiste, s’est approché d’une _expression_ où son corps est en jeu. Et si un peu de déchet humain apparait ou fait croire en son apparition, le scandale du bien séant se met à râler dans les rangs et les téléphones se mettent à sonner dans les bureaux, «Ça on ne peut pas». Et l’artiste a-il pris un risque? Non. Pas vraiment. Il s’engage dans son acte, présent à lui, ouvrant le champ des possibles et l’offrant aux spectateurs. Le théâtre a sans doute des limites dans le risque convenu qui est donné aux spectateurs. D’autres formes d’_expression_ comme la performance ou les arts plastiques engagent le corps des artistes témoignant ou symbolisant par leurs actions certains codes de représentations du monde. Dans ce cadre-là, la plupart des expressions n’engendrent aucun scandale. Y a t-il une règle acceptable de la représentation? La révolte est-elle vraiment un risque aujourd’hui ? Cela sent la bonne question. La révolte est devenu une figure de style, elle porte sa propre représentation et s’identifie comme telle. Les révoltes se sont vidées de leurs sens. Mais une société qui ne porte plus en elle de grande révolte, peut-être parce qu’elle ne porte plus d’idéologie de vie, parce qu’elle n’a plus de projet et d’idéal commun de vie, ne peut plus regarder la révolte comme acte fondateur. Aujourd’hui, la révolte a-t-elle encore un espace dans l’espace public ? La révolte exclut. Quel est l’espace où la révolte trouve encore une écoute? Est-il encore possible dans son propre pays de prendre le risque de la différence en étant semblable ? Ne sommes-nous pas en train de demander à tous les artistes d’Europe d’être pareils ? La scène Européenne donne-t-elle le goût et la sensation du risque parce que les us et coutumes des pays gardent encore un peu de leur propre origine? Un bon nombre de metteurs en scène européens présentent en France des oeuvres qui sont ici qualifiées de «risquées» – parce qu’il y a un champ qui nous paraît étrange, moins vu et donc plus exotique. Je ne crois pas qu’ils prennent plus de risque. Je pense que certains créateurs français travaillent sur des espaces similaires et qu’on ne leur donne pas l’espace de leur _expression_. Est-ce que toutes les grèves de la faim se ressemblent ? La révolte ne peut être un acte représenté. Ce qui est révolte doit aussi être le regard porté par le public sur les oeuvres représentées. Refuser la standardisation des offres, refuser le moulage des formes, refuser le formatage de la demande. Les créateurs sont des êtres de risque. Ils sont des êtres en révolte, ils n’ont besoin d’aucun risque, d’aucune révolte, ils sont le risque et la révolte. C’est aux diffuseurs et aux pouvoirs publics de prendre le risque de les représenter. Hubert Colas est auteur et metteur en scène. Il a créé Diphtong Cie en 1988 et codirige depuis 2000 le centre de création pluridisciplinaire, Montévidéo, fondé à Marseille avec le musicien-improvisateur Jean-Marc Montera, qui est consacré aux écritures et aux musiques contemporaines. |
- [rue] du risque, par Hubert Colas, laurent driss, 10/10/2012
- [rue] rue du risque, stef filok, 10/10/2012
- Re:[rue] rue du risque, boueb, 11/10/2012
- Re: [rue] du risque, par Hubert Colas, solen briand, 10/10/2012
- [rue] rue du risque, stef filok, 10/10/2012
Archives gérées par MHonArc 2.6.19+.