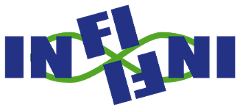-
Grall Jean Marie
Archives de la liste Aide
- From: Livchine < >
- To: Liste Liste rue < >
- Subject: [rue] Onfray parle du théâtre
- Date: Sat, 25 May 2013 07:15:20 +0200
|
MORT ET RESSURRECTION DES PERSES Autobiographie au théâtre. Dans une famille pauvre, la culture n’a pas
droit de cité. L’argent du foyer sert à survivre, pas question de financer le
supplément d’âme qu’incarne la culture dans un régime politique où l’argent
fait la loi. Avec le salaire d’ouvrier agricole de mon père et celui de femme
de ménage de ma mère, il y avait à peine , comme on disait alors à la maison,
de quoi « joindre les deux bouts » - sans que je sache alors
vraiment en quoi consistaient les bouts en question... Si mon frère ou moi tombions malade, c’était
un problème, les vêtements à changer parce que nous grandissions, c’en était un
autre. Acheter de la viande, c’était possible en début de mois, après,
arrivaient les variations sur les oeufs et les pommes de terre. Pas de
week-end, pas de vacances, pas de sorties. Pas de fêtes. Pas de tables
plantureuses. Pas de restaurant. Pas de cinéma, pas de théâtre, pas de
concerts, pas de livres, encore moins d’opéra. C’était pour les autres – qui
avaient les moyens. J’ai souvenir, dans la chambre
de dix-sept mètres carrés dans laquelle nous dormions mes parents mon frère et
moi, d’avoir découvert, l’oreille collée au transistor, sous les draps, le
« Pop Club » de José Artur en direct d’Avignon. C’étaient mes
vacances. J’avais douze ou treize ans. Le théâtre, pour moi, c’était cette voix
qui racontait un monde comme un astrophysicien aurait raconté les confins de
l’univers. Je pensais que, peut-être, un jour, je visiterais ces contrées
lointaines habitées par des noms que je découvrais : Adamov, Ionesco,
Beckett... Le théâtre, ce fut également une
autre rencontre virtuelle : des voisins ayant acheté un nouveau téléviseur, ils
avaient offert l’ancien à mes parents. Je me souviens de l’apparition de ce
gros meuble en bois vernissé dans la cuisine où nous vivions, de l’écran vert
et bombé, de la série de gros boutons sur le devant du récepteur, du point
blanc qui arrivait au centre avant l’épanouissement de l’image comme une fleur
qui s’ouvre sur un kaléidoscope en noir et blanc – plutôt en variation de
gris... Un jour, d’étranges personnages
étonnement habillés, parlant avec un débit extravagant, apparurent à l’écran...
Je me souviens de ce jour comme si c’était hier : hiératiques, masqués, incantatoires,
des corps comme des décors débitaient un texte auquel je ne comprenais rien. Le
tout était accompagné d’une musique inouïe... Interloqués, mes parents
regardaient. Puis mon père a dit : « C’est spécial... »... J’ai
souvenir de sa voix à ce moment : lui, l’ouvrier agricole disait ainsi son
étonnement, mais ne jugeait pas, ne condamnait pas... Je découvris un jour par hasard
une image de cette représentation. Il me fut facile, avec Internet, de
retrouver la trace de cet évènement : il s’agissait des Perses d’Eschyle dans la version de Jean Prat. Je retrouvais même
la date de diffusion : le 20 décembre
1966 – j’avais sept ans... Sous De Gaulle ( « fasciste » selon Sartre
et les communistes de l’époque...), en première partie de soirée, la télévision
pouvait donc exceller dans l’éducation populaire en présentait sur une chaîne
unique ce genre de programme ! J’ai la nostalgie de cette époque, non
parce qu’elle fait partie de mon passé, mais parce que j’ai cru, je crois et je
croirais toujours à l’excellence de toute entreprise d’éducation populaire. Vint un jour où, devenu auteur
de quelques livres, je fus invité à Avignon pour participer à un débat qui
posait cette question : « Que pense le théâtre ? ». Alain
Badiou, hautain, recyclant Deleuze, répondit qu’il mettait en scène des
« personnages conceptuels »... Puis, sans un regard autour de lui,
après avoir parlé comme l’oracle de
Delphes, il repartit dans sa caverne platonicienne. Il se trouvait dans le
public quelques théâtreux, des gens
pour qui le théâtre constitue avant tout une affaire incestueuse : une
activité pour initiés, une pratique culturelle élitaire, un champ théorétique
dans lequel ils se meuvent avec une poignée de gens, toujours les mêmes, sans
souci du public et encore moins du peuple. Je fis pour ma part une
intervention nominaliste affirmant que le théâtre ne pensait rien parce qu’il
ne pensait pas, mais, qu’en revanche,
les gens qui font le théâtre, eux, pensaient . Dès lors, il fallait
effectuer une sociologie pour pointer les effets de la lutte des classes dans
le théâtre puisque la costumière ne pense pas la même chose que le metteur en
scène, le directeur de festival que le comédien, le figurant que la tête
d’affiche, le responsable des finances que l’attachée de presse, l’auteur que
son éditeur. Nous étions trop loin de Platon, aux antipodes de la mode
conceptuelle qui pense le Théâtre avec une majuscule en oubliant que, dans le
monde réel et concret, les majuscules n’existent pas... Je fus plus tard sollicité par
Antoine Bourseiller, metteur en scène mythique des années soixante-dix, qui a
manifesté le désir de porter sur la scène un petit texte de moi, Le corps de mon père, une poignée de pages pour lesquelles je donnerais
tout ce que j’ai écris s’il me fallait sauver quelques lignes seulement. Sans
vouloir offenser Antoine, il avait été un grand nom à une époque ( il a
travaillé, entre autres pointures, avec Michel Simon, Maria Casarès, Gérard
Philippe, Jean-Louis Barrault, Jean-Luc Godard ou Samuel Beckett...) , il ne
l’était plus au moment où il fit cette adaptation. Entrer dans l’histoire ,
c’est souvent sortir du présent. Il m’avait annoncé un ou deux
grands noms de comédiens pour dire ce texte, puis au fur et à mesure, les
grands noms disparaissaient ... Il y en eu finalement un qui sortait d’un long
tunnel pour d’obscures raisons – de santé m’avait-il dit... Pas sûr... J’avais
souhaité un violoncelle, puisqu’il m’avait demandé un avis, il y eut un alto
joué par un violoniste... Le décor était un dessin de mon père, alors vivant,
par Vélikovic - devenu mon ami. Mais Vlada peint avec un immense talent les
morts, les cadavres, les suppliciés, les décapités, les pendus, les crucifiés.
Mon père, dessiné en pied, avait le visage qu’il n’avait pas et qu’il aurait
certainement un jour – mais dans la tombe. J’étais pétrifié par ce seul
artifice de mise en scène... J’ai assisté à l’une des
représentations. Belle folie d’Avignon, de cette grande fête du théâtre, de la
rue comme un spectacle, des flux de piétons sous la lumière d’été, du soleil
qui troue les terrasses sous les arbres ou qui inonde les places, des affiches
partout, de la lutte des classes visible là encore - les in du off, les off du
in, les in du in, les off du off... Déambulant dans les rues blanches de
lumière, je me souvenais de la voix de José Artur grésillant sur mon petit
transistor et de l’adolescent que j’étais alors - en espérant lui être resté
fidèle... Après la représentation, au
moment où la lumière revient, je vis des gens essuyer une larme, sortir des
mouchoirs, tâcher de se refaire une figure, recouvrer le masque de la civilité
. Je fus ému de cette émotion . Je venais de toucher l’essence du
théâtre : émouvoir, toucher, ébranler avec des mots dits. Les mots écrits
sont couchés sur le papier pour être lus, dans l’intimité d’un auteur avec son
lecteur. C’est une chose. Autre chose ce même texte dit. Ce qui s’avère intime
lors de la lecture devient presque obscène une fois proféré : comme un corps nu
montré dans l’intimité d’une chambre devient un corps obscène exhibé dans la
rue... Je fus très ému par ce qu’Antoine avait
obtenu avec si peu de moyens. Nous sommes aller dîner, je lui ai dit mon
émotion . Puis je lui ai demandé comment je pourrais le remercier . Il me dit
alors : « Ecris moi une pièce... ». Je rétorquais qu’on ne
s’improvise pas dramaturge, que je ne l’étais pas, que je n’avais pas de
pratique du texte théâtral, encore moins des salles de spectacle, j’avouais ma
naïveté, etc. Antoine Bourseiller me rétorqua que ces défauts pouvaient devenir
des qualités : je pouvais arriver face à ma page blanche sans les préjugés
accumulés par trop de proximité avec le milieu. Je promis d’y réfléchir. Le
lendemain matin, j’avais une idée à lui proposer. A cette époque, un jeune
manifestant italien avait été écrasé par une voiture de police lors d’une
manifestation anti-G20. J’avais envie d’une pièce politique qui montrerait une
réunion comme il y en existe à Davos avec les requins du capitalisme planétaire pendant que derrière seraient projetés des
films des manifestations, voire des images de la vie de ce jeune garçon.
J’appris le jour où j’eus ce projet qu’il avait été enterré avec sur son
cercueil le drapeau du club de foot qu’il supportait... J’abandonnais l’idée. A cette époque, dans ma chambre
d’hôtel avignonnaise, je lisais Eichmann à Jérusalem d’Hannah Arendt.
J’y appris que le criminel de guerre se référait à Kant, qu’il se disait
kantien et affirmait que l’auteur de la Métaphysique
des moeurs lui avait servi de ligne de conduite dans sa vie de nazi... Arendt pensait qu’il
avait mal lu le philosophe allemand ; pour lui avoir consacré un travail
universitaire, je savais qu’au contraire, Eichmann l’avait bien lu ! J’avais aimé Le souper de Jean-Claude Brisville, un dialogue magnifique entre
Talleyrand et Fouché. J’appréciais également, du même auteur , L’entretien
de Monsieur Descartes avec Monsieur Pascal le jeune. Je fis savoir à
Antoine Bourseiller que, sur le principe du dialogue, j’avais envie d’écrire un
échange entre Eichmann dans sa prison, quelques heures avant son exécution et
Kant qui viendrait demander au criminel
de guerre des comptes sur la lecture de son oeuvre . J’avais envisagé un
Nietzsche dans un coin, goguenard, content qu’on inverse la perspective
habituelle qui fait de Kant le philosophe emblématique de la loi morale et de
la pureté éthique et de Nietzsche, un penseur compatible avec l’hitlérisme... Ce soir-là, presque fâché, Antoine
Bourseiller trouva mon idée très mauvaise, trop dans l’ère du temps, une idée
de qui n’a pas d’idée dramaturgique... Il lâcha le nom d’ Eric –Emmanuel
Schmidt pour clore le débat, puisque le dramaturge à succès venait d’écrire une
pièce dont tout le monde parlait et qui mettait en scène Freud et Dieu – deux
de mes amis, on le sait un peu... J’écrivis tout de même cette pièce, elle est
éditée chez Galilée. Jean-Michel Ribes m’a proposé
d’organiser une lecture au théâtre du Rond-Point. Daniel Mesguich avait accepté
. Puis j’ai publié Le crépuscule d’une
idole qui découvre un Freud à
rebours de la légende : son soutien au régime austro-fasciste de Dollfuss,
la dédicace élogieuse de l’un de ses livres, Pourquoi la guerre ?, à
Mussolini, sa compromission avec le nazi Felix Boehm pour que la psychanalyse puisse continuer à
exister sous régime national-socialiste , ses manoeuvres, avec sa fille Anna,
pour évincer le juif communiste qu’était Wilhelm Reich des instances
psychanalytiques, son essai sur Moïse et
le monothéisme qui, en plein triomphe nazi, fait de Moïse un égyptien ,
etc. Comme Madame Roudinesco soutient
Freud bec et ongles, elle prit la tête d’une campagne médiatique contre moi et
fit savoir partout où elle avait des soutiens (c’est-à-dire partout...) que
critiquer Freud, c’était réactiver les thèses d’extrême droite, se faire
compagnon de route des nazis et, bien évidemment, être antisémite. Daniel
Mesguich, que je croyais doté d’un peu
esprit critique et d’un minimum d’ intelligence, souscrivit à ce diktat.
Pas question pour lui de lire la pièce d’un antisémite ! Il se récusa
donc... Elle fut lue par Dominique Pinon – que je remercie d’avoir accepté
d’accoler son nom à celui, s’il faut en croire Madame Roudinesco, d’un compagnon de route d’Adolf Hitler ! J’entrais vraiment dans le
théâtre avec Jean- Lambert Wild, le directeur de la Comédie de Caen qui, dès
son arrivée dans la capitale Bas- Normande, a souhaité me rencontrer pour
me proposer de travailler en commun. Nous avons sympathisé. Il accueille mon
cours d’Université Populaire chaque semaine et me prête son théâtre en me
faisant l’amitié de me dire que, mille personnes tous les lundis, avec juste
une table et une chaise, c’est la quintessence du théâtre ! Un jour, il m’a sollicité pour
écrire un texte à mettre en scène. Ma pièce sur Eichmann lui paraissait datée,
trop vieux théâtre, trop théâtre d’idées. Il souhaitait autre chose. J’ai écrit
pour lui Le recours aux forêts, un
texte qui n’est pas d’une facture théâtrale classique, puisqu’il n’y a pas de
personnages, pas de dialogues, pas d’intrigues, mais juste une voix qui
parle une langue que j’aimerais soeur
des Feuilles d’herbe de Whitman, mon
héros en poésie. Ce texte est devenu pièce. La
magie de son équipe a intégré ces pages dans une oeuvre qui, chacun prenant sa
place ( mise en scène, lumières, photos, musique, costumes, etc), cristallise
un ensemble dans lequel les mots tiennent leur place – pas trop, pas trop peu.
J’ai écrit une suite, La sagesse des
abeilles, elle aussi montée, puis jouée
en France et à l’étranger. Je viens de terminer le troisième volet, La constellation de la baleine, avant
un quatrième qui achèvera une tétralogie ayant pour nom Les quatre éléments. Le temps passant, après avoir publié plus
d’une soixantaine de livres, je me dis que je me trouve plus là, dans cette
poignée de pages, que partout ailleurs. Magie d’une écriture poétique -
rappelons nous l’étymologie... Et puis vint un jour Jean-Claude Idée. Comme
je suis peu suspect de sacrifier aux contes d’enfants colportés par Freud et
les freudiens, je ne vais pas dire que
son patronyme portait son destin – comme les tenants de la pensée magique
viennoise l’affirment encore aujourd’hui avec sérieux... Idée n’est pas un
pseudonyme, mais un programme ! Jean-Claude est auteur, metteur en scène,
comédien, professeur, directeur de festival. Autant dire que, lui plus qu’un autre, il peut répondre à la
question « Que pense le théâtre ? » en nominaliste – et non en
spécialiste des... Idées, avec majuscules. Il a souhaité travailler ma
pièce sur Eichmann avec ses élèves du conservatoire de Bruxelles dans le cadre
de son Magasin d’écritures théâtrales et de travailler sur mes textes avec ses
collègues et ses élèves du Conservatoire de Bruxelles . J’ai voulu que nous
nous rencontrions avant de dire oui. Nous nous sommes vu et plu. Et nous
partageons une semblable vision du
théâtre. En lui
parlant, je me souvenais, sur la grande scène d’Avignon, d’une pièce de
Jan Fabre ( dont j’aime par ailleurs le travail de plasticien) , Je suis sang, un dramaturge chouchouté
par la critique, encensé par la presse parisienne qui s’encanaille à célébrer
les flots d’urine, de sperme, de sang répandus sur scène, qui jouit de la
resucée des happenings à la mode dans les années cinquante comme autant de
modernités subversives, qui se pâme aux cris, aux hurlements, aux beuglements et autres régressions
présentées comme ... une critique du capitalisme ! On imagine les
tremblements du capital ! Un journal canadien (Le Devoir, 23 mai 2009) rend ainsi compte de l’un de ses spectacles :
« Pour dénoncer le
capitalisme et la consommation à outrance, Fabre et ses neuf interprètes
servent un bouillon d’audace. Il faut bien le dire, puisqu’il faudra le voir,
et appeler un chat un chat : mains aux culottes, orgasmes simulés, masturbation
de ces messieurs, fusil planté dans un cul, ces dames qui accouchent de boîtes
de conserve dans un panier d’épicerie, Jésus-Christ top modèle. Et injures au
public, au metteur en scène, «fuck you all» et le reste de l’univers. «Je ne
vise jamais la provocation», dit pourtant le créateur
en entrevue »- ben tiens... Le metteur en scène subversif, le
critique avisé du capitalisme, le
dramaturge se proposant de faire exploser le système, se trouve invité par la Reine Paola de Belgique à
décorer le plafond du théâtre de la Salle des Glaces du Palais Royal qu’il a
recouverte d’élytres de scarabées , il reçoit la décoration de Grand Officier
de l’Ordre de la Couronne, puis il expose au Louvre... Suite des tremblements
du capital ! Jean-Claude Idée et moi nous nous retrouvons
sur ce constat que ce genre de théâtre a pu trouver sa légitimité dans un temps
où la catharsis était nécessaire ( tout l’Actionnisme viennois se légitime une
fois mis en perspective avec l’Autriche post-nazie des années soixante...), mais
notre époque ne peut se croire d’avant-garde quand elle réactive des
vieilleries d’ un demi-siècle ! Le Porte-Bouteille
de Duchamp , c’est
révolutionnaire en 1914 ; mais un ready-made en 2013, c’est
étymologiquement (vouloir restaurer un ordre ancien disparu) réactionnaire ! Jan Fabre ( pour ne
prendre que lui ) accuse un demi-siècle de retard sur la Materialaktion d’Otto Mühl qui date de 1963 ! Que peut-on vouloir pour le théâtre si
on souhaite le sortir de cette impasse mondaine et nihiliste ? D’abord établir
un état des lieux, ce que fait Jean-Claude Idée dans le double texte ( une
prose explicative et une pièce foutraque) qui suit : règne de l’élitisme avec mépris de ceux qui résistent à ces
pitreries sérieuses ; domination du
narcissisme en vertu de quoi le nom du comédien ou du metteur en scène
passe avant celui de l’auteur du texte – on se sert du texte plus qu’on ne le
sert ; triomphe de la dépolitisation,
même si les théâtreux se réclament, à longueur de métadiscours, d’ une critique
néo-marxiste du capitalisme, d’une charge debordienne contre le spectacle ou
d’une stratégie à la Negri contre le néo-libéralisme planétaire ; création incestueuse pour les gens du
milieu ( les metteurs en scène, les critiques spécialisés, les directeurs de
festivals, les programmateurs, les comédiens) et non pour le peuple (un gros
mot) ou le public ( une quantité négligeable quand on travaille avec l’argent
du contribuable)... Ensuite, il s’agit de proposer une
positivité. Pour ce faire, il suffit d’inverser, comme les doigts d’un gant,
les reproches faits ci-dessus au théâtre
comme il est pour obtenir un programme sur le théâtre tel qu’il devrait être. Voici quelques pistes : restaurer
le public dans ses prérogatives et retrouver l’esprit qui, des Grecs
à Vilar et passant par Vitez, affirme que l’alternative ne se trouve pas entre
séduire le public ou le mépriser, mais entre se soucier de lui sans le flatter
ou s’en moquer sous prétexte que l’avant-garde éclairée de l’intelligentsia
théâtreuse dit le vrai ; remettre le texte au centre du dispositif,
ce qui exclut l’éloge daté du texte pour
le texte, la religion textuelle des structuralistes, le culte autiste des
glossolalies ; réinstaller la
critique politique au coeur de l’écriture théâtrale, non pas sur le mode du
réalisme socialiste, mais sur celui d’Aristophane ou de Molière qui
transforment la scène en lieu de contre-pouvoir libertaire aux pouvoirs en
place – le théâtre doit être l’endroit où le pouvoir se trouve inquiété et non épargné ; créer pour éduquer, et non pour fournir
du carburant au moteur autonome du cénacle des gens de la profession – éduquer,
c’est à dire initier à un monde, apprendre à le lire pour le comprendre, afin
d’y accéder pour le transformer. Jean- Claude Idée et moi avons décidé de
passer à l’acte en créant une Université Populaire du Théâtre qui se
propose de rendre le théâtre populaire –
dans l’ esprit de l’université populaire de Caen : gratuité, générosité,
bénévolat, partage, fraternité dans , par et pour la culture – en
l’occurrence : le théâtre. Je me souviens des Perses d’Eschyle et de ce que disait cette soirée en noir et
blanc : la possibilité d’offrir de la qualité à tous. L’aristocratisation du
peuple, c’était le projet de Nietzsche – celui qui avait séduit Jaurès, on le
sait peu... Voilà une autre façon de se
faire nietzschéen ! Michel Onfray |
- [rue] Onfray parle du théâtre, Livchine, 25/05/2013
Archives gérées par MHonArc 2.6.19+.