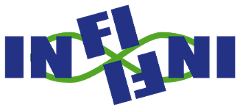ls sont dépenaillés, affamés, transis, et bruyants. Mais ils sont aussi vivifiants et sexy. Alors, quand le jeune baron de Sigognac accepte de donner l’hospitalité à ces comédiens ambulants qui viennent de frapper aux portes de son château glacial, il découvre que l’ennui n’est pas une fatalité, et décide de changer de nom et de vie : il va devenir le Capitaine Fracasse. Lorsque Théophile Gautier raconte, dans son enthousiasmant roman (1863), les tribulations d’une troupe dans la France de la première moitié du XVIIe siècle, il fixe avec affection l’image traditionnelle du saltimbanque : entre mendiant et roi d’un soir, il est libre mais vulnérable, amusant mais sans grande éducation, dévoué à son art mais d’une moralité douteuse.
Ce cliché ambigu n’est pas dû à la seule fantaisie d’un romancier. Il est nourri par des siècles de suspicion fascinée, et il n’est pas tout à fait certain que le regard ait entièrement changé. Les Eglises ont évidemment eu leur part de responsabilité dans le rejet des histrions professionnels — ainsi, tandis qu’en France les comédiens étaient excommuniés, en Angleterre les puritains, comme le rappelle Peter Ackroyd dans sa nécessaire biographie de Shakespeare, les fustigeaient en les accusant de « titiller la sexualité » et de « pratiquer le faux-semblant et contrefaire l’image de Dieu » (1), avant de se donner la joie vertueuse, à la faveur de leur victoire sur le roi Jacques Ier, d’interdire totalement le théâtre. Mais ce sont tous les tenants de l’ordre social, dans leur ensemble, qui n’ont pas davantage eu l’envie de les intégrer en tant que tels.
Il faut bien reconnaître qu’ils manquaient de tenue. A Londres, les représentations en ce temps alternent souvent avec des combats d’ours et de chiens, et ont lieu hors les murs, pour éviter les impôts, tout près des bordels. Autant dire que « théâtre et lupanars offraient un répit face à l’éthique dominante et au moralisme ambiant », ce qui évidemment prêtait à confusion. Les rixes sont fréquentes, tant entre les divers membres de la tribu (Ben Jonson, l’auteur de Volpone, tue l’acteur Gabriel Spencer en 1598) que dans le public même. Mais il y a pire. Le théâtre apparaît comme une « force démocratisante », qui s’adresse aussi bien à la « vile populace », au « rebut pétulant et impie », qu’aux privilégiés et, de surcroît, nivelle de fait la hiérarchie sociale en traitant à égalité nobles ou manants comme autant de personnages.
En bref, le comédien sent le soufre. Il est donc placé sous contrôle. Dès 1572, la loi anglaise exige que « tous maîtres d’armes, gardiens d’ours, acteurs communs d’interludes et ménestriers », à défaut d’appartenir à la domesticité d’un grand seigneur, soient fouettés et « brûlés dans l’oreille ». Les acteurs vont chercher des mécènes et tenter de conquérir un début de respectabilité, notamment en s’installant autant que faire se peut dans des théâtres (The Globe, The Rose…). Mais cela ne les préserve pas pour autant des tournées, quand la peste frappe à Londres, par exemple. Ils reprennent le chariot, vont de ville en ville demander l’autorisation de jouer, et ne parviennent pas toujours à éviter de devoir vendre leurs costumes avant de rentrer chez eux sans un penny : ils n’appartiennent à aucune guilde, seul le bon plaisir de leur maître peut éventuellement les secourir. Si le statut de l’acteur s’élève néanmoins peu à peu au-dessus de celui du mendiant ou de l’acrobate, c’est grâce au prestige de certains parrainages, comme celui du Grand Chambellan, à la troupe duquel appartenait Shakespeare, et peut-être à l’argent que certains, copropriétaires de leur théâtre, parviennent à gagner. Mais que tombe la protection, qu’une épidémie se déclare, et le comédien peut à nouveau frôler le mendiant, tandis que les prédicateurs dénoncent sa pratique comme « un acte de rébellion contre Dieu ».
En 1758, soit près de trente ans après la mort d’Adrienne Lecouvreur, interprète fameuse de Voltaire, et la dernière comédienne, semble-t-il, à qui l’Eglise refuse un enterrement en terre consacrée, Jean-Jacques Rousseau écrit sa Lettre à d’Alembert sur les spectacles. Il y condamne le comédien avec ferveur : « Qu’est-ce que le talent du comédien ? L’art de se contrefaire, de revêtir un autre caractère que le sien, (…) et d’oublier sa propre place à force de prendre celle d’autrui. » Duplicité intrinsèque, élément de désordre social par son seul exemple, l’acteur est dangereux, sinon toxique. Diderot répondra de biais, avec le Paradoxe sur le comédien (1773), en soulignant que si le théâtre devenait un facteur d’éducation et de moralisation, la profession pourrait être honorable et honorée…
C’est la Révolution française qui va enfin permettre en principe aux comédiens de prendre toute leur place dans la société civile, en leur conférant une citoyenneté à part entière. A partir de 1810, le nom des interprètes apparaît enfin sur les affiches, et, tout au long des bouleversements du siècle, des stars vont faire de leurs rôles de « puissants symboles sociopolitiques (2) », et parfois même prendre parti ouvertement. L’ancien ouvrier Bocage, fameux pour ses rôles dans les pièces d’Alexandre Dumas et républicain affirmé, fait un usage militant de la scène en choisissant avec Félix Pyat un dramaturge qui convient à ses convictions. Et quand l’orchestre murmure, il sait lui demander : « Est-ce à l’homme politique ou à l’artiste que vous en voulez ? » Frédérick Lemaître, celui-là même qu’on croise dans le film de Marcel Carné Les Enfants du Paradis, est un grand improvisateur, qui infléchit si bien les mélodrames qu’il les fait résonner d’échos à l’actualité absolument étrangers à leurs auteurs. La tragédienne Rachel chante La Marseillaise sur scène en 1848. Les comédiens seraient-ils en train de devenir des citoyens et des travailleurs comme les autres ? On pourrait le croire, d’autant que, en 1840, le baron Taylor, longtemps administrateur du Théâtre-Français, a créé l’Association des artistes dramatiques, une association de secours mutuel destinée à aider les comédiens et chanteurs dans le besoin, et à financer une caisse de retraite grâce aux cotisations ainsi qu’aux galas de bienfaisance. Mais elle n’accueille que les artistes « chics », ceux des théâtres subventionnés, que fréquentent les couches favorisées…
Quarante ans plus tard, alors même que la proportion d’acteurs issus des classes moyennes et ayant fait des études longues augmente sensiblement, alors même que Sarah Bernhardt, communément surnommée « la Divine », fait des tournées sur les cinq continents, le mépris du saltimbanque demeure toujours vivace, à la mesure de son succès, et de sa fragilité. L’écrivain Octave Mirbeau, proche des anarchistes, peut affirmer que le comédien, de par sa nature même, est un être inférieur et un réprouvé. Du moment où il monte sur les planches, il a fait l’abdication de sa qualité d’homme » (Le Figaro, 26 octobre 1882). Coquelin l’aîné, l’interprète légendaire de Cyrano, ici plus ou moins directement visé, avait répondu par avance dans L’Art et le comédien (Ollendorff, Paris, 1880) : « Le comédien est un artiste et il a sa place dans un Etat au même titre que tous les citoyens. »
Sans doute… Mais il y a à l’évidence artistes et artistes. Car précisément, « de par sa nature même », le comédien reste équivoque, à tout le moins, surtout quand son public paraît peu fréquentable. Tout naturellement, comme le rappelle Marie-Ange Rauch (3), les amuseurs, chanteuses, fantaisistes divers qui se produisent dans les très nombreux cafés-concerts (caf’conc’) de Paris et sa banlieue ne sont pas reconnus comme faisant partie de la « grande famille » du spectacle. Exclus de la mutuelle « Taylor », exclus de toute légitimation par l’art. Même Coquelin, qui a fondé une maison de retraite en 1905 à Pont-aux-Dames, la réserve aux acteurs pouvant témoigner de « bonnes mœurs ». C’est que, dans les beuglants et bouis-bouis, l’ouvrier va « se jeter à travers les jouissances brutales où l’homme se complaît », selon la forte _expression_ de Maxime Du Camp, l’ami de Gustave Flaubert, et ceux qui y travaillent et contribuent ainsi à « l’avilissement » de la populace ne valent évidemment pas mieux. Splendidement, le caf’conc’ va se battre pour être distingué des lieux de prostitution, et affirmer la dignité sociale des siens par la défense de leurs droits à la protection sociale. Dans la plupart de ces salles, le public « consomme » et ne paie pas de droit d’entrée. Les femmes doivent faire la quête et sont priées de mettre en avant leurs charmes. Quant aux hommes, ils sont moins payés que les serveurs…
Jules Pacra (1833-1915), qui pratique avec succès la « chansonnette distinguée » et connaît aussi bien les caf’conc’ de luxe (l’Eldorado) que les planches populaires, a rejoint les communards et participé à l’élaboration de la première Fédération artistique. En 1880, il décide, avec quelques confrères, dont le chansonnier Aristide Bruant, qui ouvrira son cabaret Le Chat noir un an plus tard, de créer la Société de secours mutuel des artistes lyriques, celle des « laissés-pour-compte » afin de leur donner accès aux soins, à une pension, et de défendre leurs droits. La recherche du financement (cotisations, dons, galas) se double d’une recherche de respectabilité, via le soutien de vedettes fréquentables, tandis qu’un autre artiste de caf’conc’, Raymond Broca, fonde en 1890 la Chambre syndicale des artistes dramatiques, lyriques et musiciens, plus revendicative. Quand Dranem, l’inoubliable interprète de Pétronille, tu sens la menthe, achète un château à Ris-Orangis pour l’offrir comme maison de retraite à ses camarades et qu’elle est inaugurée en 1911 par le président de la République, on peut penser que c’est gagné, tant pour la respectabilité que pour les droits. Rien n’est moins sûr. Le château a été vendu, la mutuelle de Pacra a rejoint en 2011 le groupe Audiens, qui, lui, ne connaît pas le déficit, et « les idées fausses sur les professionnels du spectacle (4) » fleurissent toujours, mais elles se sont « modernisées » : elles portent avant tout sur leur régime d’intermittence, qui les consacrerait comme autant de « profiteurs ».
Jadis, Diderot, pour les défendre, affirmait qu’ils étaient dissolus en miroir des valeurs du temps. Aujourd’hui, pour justifier leurs droits, on parle économie. En 2004, le rapport Guillot remis au ministre de la culture et de la communication, dans l’émotion suscitée par l’annulation du Festival d’Avignon, souligne qu’en 2003 « la valeur ajoutée dégagée par le secteur du spectacle vivant et enregistré (…) équivalait à celle de la construction aéronautique, navale et ferroviaire ». Depuis, l’argument comptable est régulièrement brandi comme légitimation… Triste réponse, qui accepte la domination de la rentabilité comme raison d’être. Pauvre excuse, qui refuse d’affirmer la nécessité du jeu, du travail gratuit de l’imaginaire à partager, du luxe de la représentation des rêves des humains, autant de facteurs de… désordre.