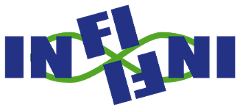-
Grall Jean Marie
Liste arts de la rue
Archives de la liste Aide
- From: francoismary < >
- To: Liste Liste rue < >
- Subject: [rue] Calais, cul de sac de l'Europe
- Date: Sat, 09 Nov 2019 10:29:23 +0100
- Importance: normal
- Savedfromemail:
| En 2019, l’Europe compte ses murs www.liberation.fr Le Rideau de fer s’est déchiré il y a trente ans. L’Europe célèbre partout sa réunification, les images de liesse de la chute du mur de Berlin tournent en boucle sur les écrans de télévision. Que fête-t-on, au juste ? La débâcle du bloc soviétique ? Après trois décennies de libéralisme, le triomphe du «camp» capitaliste a un mauvais arrière-goût, économique comme écologique. La «fin de l’histoire» promise par Francis Fukuyama ? Théorie démodée, à l’heure des convulsions mondiales du modèle démocratique et du retour en force de l’autoritarisme (lire pages 6-7). Reste les libertés. De parler, d’écrire, de débattre, de critiquer, de voter. Et la première offerte par la chute du Mur, le 9 novembre 1989 : celle de se déplacer, de réunir des familles, de voyager, d’émigrer. Avec l’espace Schengen, l’Union européenne a poussé très loin l’abolition des frontières : dans le prolongement de la chute du Mur, elle a permis à ses citoyens de passer d’un pays à l’autre sans visa, donc sans contrôle gouvernemental. Au fur et à mesure que l’Europe faisait disparaître ses bordures internes, elle en a pourtant érigé de nouvelles, sur ses contours externes. Le mur Est-Ouest a été remplacé par un mur Nord-Sud, plus long et plus haut que le Rideau de fer. Au tournant des années 2000, le continent commence à se refermer sur lui-même. La coupure n’est plus dictée par un affrontement idéologique entre deux puissances, mais par une peur - économique, politique, culturelle, sécuritaire - de l’étranger venu de Syrie, du Nigeria, de Chine, de Tunisie, du Bangladesh, d’Afghanistan, d’Erythrée, etc. Lors de la crise migratoire de 2015, l’Europe finira de se barricader. Les rares points de franchissement de la frontière extérieure de l’Union européenne sont aujourd’hui devenus des noms familiers. Des images aussi : l’enclave de Ceuta et ses hautes grilles qui séparent l’Espagne du Maroc, les îles de Lampedusa (Italie) ou Lesbos (Grèce) et leurs réfugiés en gilets de sauvetage, ou les campements de tentes de Calais… Ils forment, en pointillé, ce nouveau mur européen. A la différence du soviétique, celui-ci offre des possibilités de passage. Depuis 2010, l’UE a accordé l’asile à 1,2 million de réfugiés. L’Allemagne elle-même a accueilli sur son sol plus d’un million de migrants en 2015. Mais ce nouveau rempart est aussi plus mortifère. Plusieurs centaines de personnes ont péri en tentant de franchir le Rideau de fer. Ces cinq dernières années, 17 419 exilés sont morts aux portes de l’Europe. A Calais, le 26 septembre, dans la zone industrielle des Dunes, des grilles financées par le Royaume-Uni. Photo Aimée Thirion Ceuta, toujours plus haut Il existe seulement deux points de jonction terrestres entre l’Afrique et l’Union européenne : Ceuta et Melilla, les enclaves espagnoles situées au nord du Maroc. Des deux, Ceuta est la plus convoitée. Sa frontière serpente sur huit kilomètres au milieu des rochers, depuis le poste-frontière de Tarajal jusqu’à celui, fermé, de Benzu. Le grillage qui la dessine, parsemé de cabanes de surveillance éclairées de jour comme de nuit, est visible de loin. Haute de six mètres, la barrière métallique érigée à la demande de l’Europe il y a dix-huit ans (pour un coût de 30 millions d’euros) sera relevée dans les prochains mois. Elle atteindra dix mètres, la taille d’un immeuble de trois étages. Madrid a aussi promis le retrait de la «concertina», un fil barbelé serti de petites lames de rasoir qui dévore la chair et les habits. A Ceuta, chaque jour, de jeunes Marocains, Erythréens ou Soudanais se pansent les mains ou les jambes, là où les barbelés ont attaqué leur peau et leurs manteaux. Le 30 août à l’aube, à la faveur d’un épais brouillard, 155 d’entre eux ont réussi à escalader les hautes barrières de la frontière. Malgré tous les efforts des gouvernements, ces huit kilomètres de séparation, en plein cœur d’une région montagneuse, accidentée, n’ont jamais été totalement imperméables. Du côté espagnol, la police s’est équipée de caméras à vision nocturne, de câbles et de détecteurs de bruit, enterrés, pour prévenir de tout mouvement. Et du côté marocain, où les petits cabanons de guet se succèdent le long de la frontière, la terre est remuée, terrassée, des tentes et campements de l’armée sont installés et des jeeps patrouillent. Un no man’s land sépare désormais la double barrière, l’espagnole et la marocaine, offrant plus de visibilité aux forces de sécurité. Pourtant, année après année, les candidats à l’exil continuent de passer. Ils étaient 4 961 en 2018 à avoir franchi les barbelés. L’an dernier, ce sont surtout des enfants marocains, cartable sur le dos, qui s’agrippaient sous les camions, quittant le port à bord de ferries en direction de l’Espagne. De l’autre côté, «c’est la liberté»,disait en février Salah, 17 ans, originaire de Martil, un village marocain proche de la frontière. Kerkennah, entre deux mondes «Si tu arrives à Kerkennah, c’est comme si tu étais déjà en Europe», promet un rabatteur installé à Tunis. L’archipel, à 20 kilomètres du continent africain et à 150 de l’île italienne de Lampedusa, est un tremplin. L’Afrique dans le dos, l’Europe à portée de main. Pour beaucoup de migrants, fouler le quai de Sidi Youssef, au sud de Kerkennah, marque la fin d’un périple terrestre entamé plusieurs mois plus tôt de l’autre côté du Sahara. Qu’importe donc si les premiers pas peuvent se révéler glissants à cause des poissons jetés négligemment par les marins qui trient leur pêche à même le débarcadère. Qui sait d’ailleurs si l’un de ces pêcheurs indélicats ne sera pas, demain, le pilote qui conduira le bateau à destination de l’île italienne ? La surpêche aux chaluts et aux crabes bleus, prédateurs récemment arrivés sur les côtes, ont vidé les fonds marins, obligeant les travailleurs de la mer à se diversifier. Kerkennah n’a rien d’une île touristique. L’endroit, plat, est balayé par le vent et la salinité du sous-sol offre un paysage de terre aride, hérissé de quelques palmiers aux dattes sèches, peu sucrées. Ici, les migrants mettent à profit quelques jours de tranquillité avant le départ pour appeler et rassurer leurs proches. Ils sont installés par dizaines dans des gouna, les maisons abandonnées réquisitionnées par les passeurs, où ils dorment sur des matelas sans âge, posés à même le sol. Les risques d’arrestation sont minimes. Les policiers du coin ne sont pas obsédés par la chasse aux harraga (les «brûleurs de frontière») tunisiens et subsahariens. «Il existe une complicité des autorités. Au port de Sfax [d’où embarquent les passagers pour Kerkennah, ndlr], il est facile de repérer ceux qui veulent partir. Ils ont tous de longs manteaux même s’il fait chaud, en prévision de la traversée qui a lieu la nuit. Mais la police ferme les yeux. Si on les laisse venir jusqu’à Kerkennah, ce n’est pas pour les arrêter ici», assure Ahmed Souissi, ancien responsable de l’Union des diplômés chômeurs de Kerkennah. Les voyageurs de passage dorment, mangent, en attendant le mot d’ordre : «C’est pour ce soir.» Alors, à la nuit tombée, ils se dirigent vers le nord en direction du port d’Al-Attaya. Autrefois haut lieu de la pêche aux poulpes, le site a perdu de sa superbe. Des filets rafistolés s’entassent en vrac sur le ponton où sont amarrés des chalutiers rouillés et des vieux bateaux de bois à fond plat, sur lesquels embarqueront les clandestins. Ahmed Arous, quarante ans de pêche derrière lui, en a vendu deux, pour plus de 2 000 euros. «Mais j’ai toujours refusé de jouer les pilotes», assure-t-il, conscient du danger de sortir des eaux peu profondes de Kerkennah avec un bateau rendu difficilement manœuvrable par la surcharge des passagers. Après plusieurs naufrages macabres et le renforcement des contrôles en mer par l’Union européenne, les réseaux de passeurs promettent qu’ils ont amélioré la qualité du «service». Selon l’agence Frontex, 1 347 migrants sont partis de Tunisie de janvier à août, contre 4 016 l’an dernier sur la même période. A Coquelles, le 29 septembre, à la sortie d’un parking, un grillage qui empêche de s’introduire dans le tunnel sous la Manche. Photo Aimée Thirion Leptis Magna, la plus meurtrière Il fut un temps où la Méditerranée était le contraire d’une frontière. Les Grecs, les Phéniciens, les Romains, les Vénitiens, entre autres, la considéraient comme un espace de circulation commun, un trait d’union reliant les cités des deux rives. Pendant des siècles, Athènes ou Rome furent infiniment plus proches d’Alexandrie ou Carthage que de Paris ou Berlin. En Libye actuelle, Leptis Magna, la ville natale de l’empereur Septime Sévère, en témoigne : le vestige le plus spectaculaire du site portuaire antique est un arc de triomphe majestueux aux portes ouvertes sur l’Europe. La guerre a depuis longtemps chassé les touristes. Le parking géant, écrasé de soleil, semble disproportionné pour les quelques voitures des habitants de Khoms, la ville moderne construite autour de Leptis, qui viennent pique-niquer dans les herbes folles, entre les thermes d’Hadrien et l’amphithéâtre romain. Plus personne ne fait payer l’entrée. A l’ombre des pins, sur la terrasse d’un bureau abandonné, des hommes en treillis boivent des sodas fluorescents, leurs armes posées contre un muret. Ils sont là pour dissuader les pillards. Les migrants, eux, se tiennent à distance prudente des ruines et de leurs gardiens. A quel moment «Mare Nostrum», comme l’appelait Jules César, s’est-elle transformée en obstacle ? En novembre 2019, des rivages de Leptis Magna, s’élancent chaque semaine des embarcations de fortune, souvent de simples canots pneumatiques, qui mettent cap au nord au plus noir de la nuit. Cette année, les plages nues de la région de Khoms constituent la zone de départ la plus prisée des passeurs libyens. Au sud, la ville est directement reliée à Beni Walid, plaque tournante du trafic d’être humains, pompe à migrants subsahariens qui, après les avoir dépouillés de leur argent, les propulse vers la mer, et parfois vers la mort. En Libye, la frontière ne se voit pas. Elle est là-bas, derrière la ligne d’horizon, à quelques dizaines de kilomètres, en haute mer. Il n’y a ni murs, ni grillages, ni barbelés, ni même une bouée pour matérialiser la séparation. C’est pourtant la porte vers l’Europe la plus meurtrière. Cette année, 694 personnes sont mortes en tentant la traversée (14 739 depuis 2014). Les chiffres de l’Organisation internationale pour les migrations ne comptabilisent que les corps retrouvés - repêchés ou échoués. Personne ne connaît le nombre réel des victimes englouties par la Méditerranée. La plupart des exilés interceptés en mer par les garde-côtes libyens, équipés et formés par des pays européens, sont débarqués au port de Khoms. Certains sont enfermés dans les centres de détention «officiels» du ministère de l’Intérieur, en réalité gérés par des milices, où ils croupissent pendant des mois, voire des années. D’autres sont envoyés ou vendus à des trafiquants, torturés, violés, entassés dans des mouroirs en attendant de pouvoir retenter une sortie en mer. Ceux qui parviennent à s’enfuir se terrent pour échapper à l’ultraviolence d’un pays sans Etat, plongé dans un conflit interminable depuis la chute du dictateur Muammar al-Kadhafi, en 2011. La Libye compterait environ 700 000 clandestins sur son territoire, dont 45 000 demandeurs d’asile enregistrés par le Haut-Commissariat aux réfugiés qui rêvent de franchir cette mer. Lesbos, le purgatoire De l’autre côté du miroir. Sur l’île de Lesbos comme sur celles de Samos, Kos ou Symi, les lumières d’en face semblent si proches, on pourrait se croire au bord d’un lac. De petits bateaux proposent la traversée aux touristes. De 20 à 40 euros, pour s’offrir un parfum d’Orient, pendant quelques heures, entre deux farniente à la plage. Mais ce trajet ne marche que dans un sens. Ou plutôt pour une seule catégorie de citoyens : les Européens, et ceux qui disposent d’un visa leur permettant d’aller et venir librement entre ces deux rives, entre les îles grecques et la Turquie. Pour tous les autres, le nouveau mur de la mer Egée se révèle très onéreux (entre 1 500 et 3 000 dollars, entre 1 350 et 2 700 euros environ, le passage). Et surtout dangereux, puisqu’il s’agit de le franchir de nuit pour échapper aux garde-côtes, sur des embarcations fragiles voire défectueuses qui vacillent facilement quand le vent se lève. Depuis le début de l’année, près de 70 personnes, en majorité des femmes et des enfants, se sont noyées pendant cette traversée. Malgré les risques et le coût, ils sont pourtant toujours plus nombreux à tenter le passage : en 2019, la Grèce est redevenue la principale porte d’entrée des routes migratoires en Europe, avec 60 % des arrivées, soit 46 100 cette année jusqu’au 30 septembre. Certes, on ne retrouve pas encore l’afflux massif de 2015, mais malgré la signature du fameux accord entre l’UE et la Turquie en mars 2016, les arrivées n’ont jamais cessé. Depuis peu, elles augmentent à un rythme exponentiel. En juillet, plus de 5 000 personnes ont accosté sur les îles grecques, leur nombre est monté à 8 000 en août, puis 10 000 en septembre. Rien que la semaine dernière, entre le 28 octobre et le 3 novembre, trente bateaux se sont échoués sur les côtes grecques avec 1 098 personnes à bord. Le président turc, Recep Tayyip Erdogan, est souvent accusé d’ouvrir les vannes au gré de ses relations tumultueuses avec l’Europe. En réalité, de début juillet à fin septembre, les garde-côtes turcs ont intercepté plus de 25 500 personnes qui tentaient la traversée. Ils retenteront certainement leur chance. Chaque départ, chaque tentative de franchir ce mur, est une décision individuelle. Elles s’additionnent à l’infini sans aucun plan collectif. A l’arrivée, ils doivent attendre sur l’île où ils accostent l’issue de leur procédure, qui prend souvent un à deux ans. Pendant ce temps-là, il faut survivre dans des camps de réfugiés de plus en plus surpeuplés. Sur l’île de Lesbos, celui de Moria est devenu le plus grand d’Europe. Prévu pour accueillir 3 000 personnes, il en abritait 4 500 en mai. Et plus de 14 500 fin octobre. Quatre heures de queue pour obtenir un repas infect, toilettes et douches rouillées, insuffisantes et crasseuses, absence de chauffage et souvent d’électricité, matelas posés sur la terre au milieu des rats et des serpents… En Hongrie, la double clôture Les policiers se déplacent seulement quand l’alarme sonne. Elle est souvent déclenchée par les oiseaux qui se posent sur la clôture. Des haut-parleurs installés tous les 100 mètres diffusent le même message en anglais, en arabe, en ourdou : «Attention ! Vous êtes à la frontière, sur un territoire qui appartient à la Hongrie. Si vous vandalisez la clôture, si vous la franchissez illégalement ou tentez de la franchir, vous commettrez un crime. Ceci est un avertissement : ne commettez pas ce crime. Vous pouvez déposer votre demande d’asile dans la zone de transit.»De part et d’autre de la frontière avec la Serbie, c’est le même paysage de bois et villages qui se ressemblent, éparpillés entre des champs de blé. Un terrain si plat qu’en 2015, 400 000 réfugiés n’ont eu aucun mal à franchir la frontière. Guidés par les passeurs, ils traversaient les champs ou longeaient la voie ferrée. Aujourd’hui le petit train ne circule plus : la voie est coupée par la «clôture antimigrants» voulue par le nationaliste Viktor Orbán, Premier ministre hongrois. En 2015, les autorités ont d’abord érigé un grillage de plus de trois mètres de haut, surmonté de barbelés, sur la quasi-totalité de la frontière. Mais la barrière étant facile à cisailler, les Hongrois ont achevé en 2016 un deuxième mur «intelligent», lui aussi hérissé de barbelés, équipé de caméras infrarouges et de capteurs de chaleur et de mouvement. La double clôture court sur 175 km, s’interrompant seulement sur quelques dizaines de mètres, là où un bout de rivière sépare les deux pays. «Des clandestins tentent parfois la traversée sur des bateaux pneumatiques mais nous les repérons facilement avec nos caméras», indique une policière hongroise. Entre les deux grillages, distants d’environ sept mètres, une route a été aménagée pour la circulation des véhicules de police. Quelque 3 000 hommes et femmes surveillent la frontière. A quelques kilomètres du mur, en territoire serbe, des groupes de jeunes Afghans et Pakistanais ont trouvé refuge dans une ferme en ruines. Mohammed Ousman, un Afghan de 21 ans, a franchi la clôture de nuit plus de dix fois, mais s’est fait refouler et rouer de coups par les policiers hongrois. Tous sont prêts à réessayer. Ils savent qu’ils n’ont aucune chance d’être admis comme demandeurs d’asile légaux dans les «zones de transit». Destinées à accueillir «ceux qui frappent légalement à notre porte», avait promis Orban, il s’agit de deux camps situés tout près de la double clôture. Les réfugiés sont logés dans de petits containers bleus, sur un terrain ceint de grillages et gardé par des policiers. C’est ici qu’échouent les plus vulnérables, les malades, les familles avec enfants, les handicapés. Ils sont actuellement plus de 300, originaires d’Irak, d’Afghanistan, d’Iran, qui ont demandé l’asile à la Hongrie. Mais le gouvernement Orban a érigé un autre mur, juridique celui-là, qui permet de rejeter quasi automatiquement les demandes d’asile. Terespol, le verrou oriental A Terespol, petite ville polonaise tranquille, seuls les nombreux bureaux de change annoncent la proximité avec la Biélorussie. C’est pourtant l’un des points de passage les plus actifs du pays, qui en compte 70 pour 3 500 kilomètres de frontière. Au poste de contrôle routier, grillagé et vidéosurveillé, les voitures, plus nombreuses à entrer qu’à sortir de l’UE, patientent en attendant la vérification des passeports, systématique, et des véhicules, optionnelle. Dernière grosse prise : 200 kilos de haschich. Ce ne sont moins les migrants qui préoccupent les garde-frontières polonais que les trafics en tout genre. A la gare de Terespol, les quais sont grillagés et surveillés. Depuis 2014, c’est par ce train qu’arrivent de Brest (la ville biélorusse) chaque jour ou presque, des dizaines ou des centaines de Tchétchènes, dans l’espoir d’obtenir l’asile politique en Pologne. «La plupart du temps, après un entretien de cinq minutes, leur demande est rejetée et ils repartent à Brest en train. Avant de revenir le lendemain, et les jours suivants», explique Joanna Subko, du bureau de médiateur des droits de l’homme. «A part quelques Vietnamiens, il n’y a pratiquement pas de migration illégale en Pologne», explique Ewa Moncure, la porte-parole de Frontex, l’agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes. C’est pourtant à Varsovie que se trouve son siège, conséquence de l’élargissement de 2004, année de la création de l’agence. «Nous avons cinq personnes déployées en Pologne. A titre de comparaison, en Grèce ils sont 677», poursuit la porte-parole. Avec la crise des réfugiés de 2015, Frontex a étendu ses prérogatives et s’apprête à recruter 700 garde-frontières. «La frontière extérieure de l’UE a besoin de 5 000 officiers supplémentaires»,conclut Ewa Moncure. La Pologne a aussi décidé d’investir dans la protection de ses frontières : pour la période 2017-2020, une enveloppe de 3,28 milliards d’euros a été débloquée. Calais, le cul-de-sac Sortie de l’autoroute, en suivant Calais-Est. Le panneau clignote au-dessus de la rocade portuaire, en anglais, en français : «Ralentir, risque de piétons et d’obstacles sur la chaussée». C’est le premier signe de la frontière. Ceux qui n’ont pas l’habitude le trouvent choquant, les autres ne le voient plus. Les migrants étaient prêts à tout pour embarquer à bord des poids-lourds vers l’Angleterre. Ils traversaient la double voie pour rejoindre les parkings, y dressaient des barrages pour provoquer des embouteillages et en profiter pour grimper sous les essieux, ou dans la remorque. La pratique s’est perdue, le message est resté. Calais est le cul-de-sac de l’Europe, la fin de l’espace Schengen, dont le Royaume-Uni ne fait pas partie. Le pays a négocié que tous ceux qui veulent entrer sur son territoire soient contrôlés en France. Alors, depuis 2004 et le traité du Touquet, les forces de l’ordre françaises retiennent sur le continent ceux qu’ailleurs elles empêchent de venir. Dans le début de soirée pluvieux, scintillent les rassurantes lumières d’une station-service. La dernière avant le port ferry. L’enseigne Total se profile au-dessus d’un mur de béton lisse, trois mètres de haut, surmonté de rouleaux de fil barbelé. C’était l’un des spots prisés pour grimper dans les camions, mais en janvier, le préfet a convaincu Total de se barricader. Dans un coin, un fourgon de CRS assure la surveillance. A l’intérieur, des routiers ont pris leurs aises, avec des cafés chauds, on se salue entre habitués. Anastasios, un Grec, qui fait souvent des allers-retours avec l’Irlande, balaie l’air d’un geste : «On dirait une prison, mais on est plus en sécurité. Avant, c’était trop simple de s’introduire.» Après la station-service, commence vraiment le mur de Calais. La double voie devient un corridor grillagé, qui mène à l’embarquement, jusqu’au pied des contrôles frontaliers. Des barrières blanches, hautes, qui hachurent le paysage d’usines et de landes, le rendent flou avec la vitesse. Le Royaume-Uni l’a financé, pour 15 millions d’euros. Frédéric, un riverain, approuve : «Depuis qu’il y a les grilles, je n’ai plus les hélicoptères au-dessus de ma maison la nuit.» Leur phare puissant était nécessaire pour débarrasser en urgence la rocade des barrages improvisés. Ailleurs dans la ville, le mur est insoupçonnable et les migrants presque invisibles, depuis le démantèlement de la grande «jungle de Calais», en octobre 2016. Ils ont été jusqu’à 10 000, d’après les associations, ils sont encore 600. Stéphanie Maurice (à Calais) , Florence La Bruyère (en Hongrie) , Célian Macé (à Leptis) , Maria Malagardis (à Lesbos) ,Mathieu Galtier (à Kerkennah) , Justine Salvestroni (à Terespol) , Louis Witter (à Ceuta) Bien à vous, François |
- [rue] Calais, cul de sac de l'Europe, francoismary, 09/11/2019
Archives gérées par MHonArc 2.6.19+.