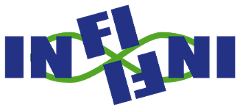-
Grall Jean Marie
Liste arts de la rue
Archives de la liste Aide
- From: Fabien moretti < >
- To: cie albedo < >
- Cc: Liste rue < >
- Subject: Re: [rue] se federer pour se brader
- Date: Thu, 31 Jan 2013 11:48:17 +0100
Salutatoi brocanteur... Se fédérer pour défendre une façon de voir la rue, ne pas se sentir seul, s'enrichir des différences en acceptant le travail de l'autre, c'est assez riche .... C'est humain. Nous sommes des animaux à l'instinct grégaire. A. − 1. [En parlant de certains animaux et aussi de l'homme] Qui vit par troupeaux. Animaux grégaires (Ac.). ♦ Instinct grégaire. Tendance instinctive qui pousse des individus d'une même espèce à se rassembler et à adopter un même comportement. M. Trotter déduit les phénomènes psychiques propres à la foule d'un instinct grégaire(gregariousness) inné à l'homme comme aux autres espèces animales. Au point de vue biologique, cette grégarité n'est qu'une _expression_ et une conséquence de la pluri-cellularité (Freud, Psychol. collective et analyse du moi, trad. de l'all. par S. Jankélévitch, Paris, Payot, 1924, p. 77).Le même instinct grégaire qui pousse les moutons dans les champs à entourer la brebis sur le point d'agneler (Guèvremont, Survenant,1945, p. 179). 2. P. anal. [En parlant d'une plante] Qui pousse dans des groupes compacts de plantes congénères. Plantes grégaires. Tout le reste est hêtres, chênes, charmes, châtaigniers, arbres grégaires, sociaux, comme les hommes de nos zones (Michelet, Journal,1834, p. 118). B. − Au fig. [À propos de l'homme, de son comportement, etc.] 1. Qui résulte de la vie en communauté et qui est propre à la foule. Sentiment, opinion grégaire (Ac.). Je ne sais quelle méchanceté grégaire m'apparente aux brutes du hameau (Genevoix, Assassin,1948, p. 82) : 1. Les enfants qui vivent en commun ont tous ce que les philosophes appellent l'âme grégaire. Ce caractèregrégaire est à la fois le danger ou le bienfait possible de l'éducation en commun. Barrès, Cahiers, t. 7, 1909, p. 226. 2. Gén. péj. Qui tend à suivre docilement les impulsions du groupe. Synon. moutonnier.Tendance, mentalité grégaire : 2. ... l'écrivain solitaire [Drumont] avait discerné du premier coup que le foudroyant succès d'un tel homme [Boulanger] restait hors de proportion avec son mérite, s'expliquait naturellement par la veulerie, l'espritgrégaire du public, ce qu'on devrait appeler d'un nom ignoble, de son vrai nom, la vacherie. Bernanos, Gde peur,1931, p. 220. Le 31 janv. 13 à 10:58, cie albedo a écrit :
|
- [rue] se federer pour se brader, cie albedo, 31/01/2013
- Re: [rue] se federer pour se brader, Fabien moretti, 31/01/2013
- Re: [rue] se federer pour se brader, Corinne PAIN, 31/01/2013
- Re: [rue] se federer pour se brader, boueb, 31/01/2013
- Re: [rue] se federer pour se brader, cie albedo, 31/01/2013
- Re: [rue] se federer pour se brader, Compagnie Progéniture, 31/01/2013
- Re: [rue] se federer pour se brader, ouffoks, 31/01/2013
- Re: [rue] se federer pour se brader, Perrine Anger-Michelet, 31/01/2013
- Re: [rue] se federer pour se brader, cie albedo, 31/01/2013
- RE: [rue] se federer pour se brader, stef filok, 31/01/2013
- Re: [rue] se federer pour se brader, Fabien moretti, 31/01/2013
- <Suite(s) possible(s)>
- Re: [rue] se federer pour se brader, cie albedo, 31/01/2013
- Re: [rue] se federer pour se brader, Stéphane Detrain, 31/01/2013
- Re: [rue] se federer pour se brader, Fabien moretti, 31/01/2013
Archives gérées par MHonArc 2.6.19+.